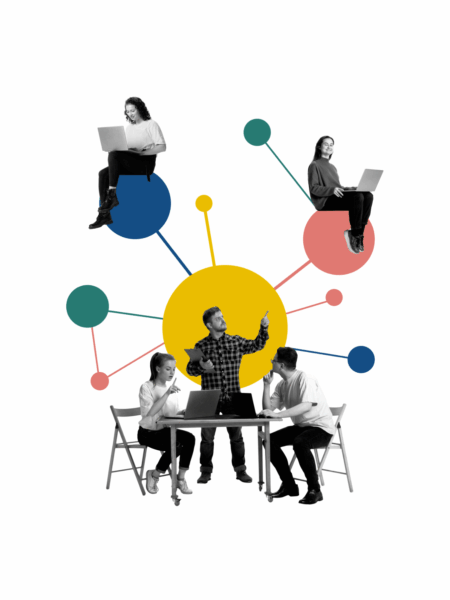Dans le secteur des assuétudes
En pleine crise du Covid, la FEDITO BXL (Fédération bruxelloise des institutions pour toxicomanes asbl) a créé un groupe de travail « Femmes, genre & assuétudes ». La raison ? Plusieurs associations du secteur bas seuil assuétudes de Bruxelles, qui assuraient des permanences pluridisciplinaires dans différents lieux sur le territoire de la capitale, se sont retrouvées à devoir gérer un public de femmes précarisées confrontées à de multiples problèmes, dont ceux de violences et d’assuétudes. Au square de Meeûs, par exemple, dans un espace mis à la disposition du Samu Social pour accueillir des femmes, les associations partenaires se sont senties un peu perdues face aux femmes qui venaient s’y mettre à l’abri.
En novembre 2021, une matinée de réflexion a été organisée et elle a réuni des travailleurs du secteur assuétudes, mais aussi ceux du secteur précarité. Le succès de la rencontre et l’intérêt manifesté pour les questions de genre, précarité et assuétudes ont alors incité à lancer le groupe de travail « Femmes, genre & assuétudes ». Comme l’explique Sophie Godenne (Dune asbl), membre de ce groupe de travail (GT), « L’idée était de se rencontrer et d’échanger sur nos expériences, nos constats et nos vécus. Et aussi de partager sur les projets déjà mis en place dans les secteurs précarité, assuétudes et santé. Il y avait aussi cette idée de se rassembler autour de nos constats, d’en faire quelque chose de plus construit, ensemble. Le but à terme étant de faire du plaidoyer, de porter la voix de nos publics et de notre secteur. »
Quelques constats ressortent déjà du travail mené par le GT. A bien des égards, la précarité reste un dénominateur commun à de nombreuses bénéficiaires. Il faut aussi noter le manque de visibilité des femmes consommatrices et ex-consommatrices de drogues, dans les services d’aide et dans l’espace public. A Dune (comptoir de réduction de risques) par exemple, elles représentent 10 à 15% du public accueilli. Ce pourcentage peu élevé a suscité également de nombreuses questions au sein de l’équipe : « comment se fait-il qu’elles soient difficiles à toucher ? Et même quand on arrive à les toucher, comment expliquer qu’elles aient du mal à arriver jusqu’aux structures d’aide et qu’elles y restent pour une prise en charge et une continuité de suivi, etc. ? »
Si on observe un enchevêtrement des problèmes que connaissent ces femmes, les violences auxquelles elles sont confrontées et leur fréquence restent néanmoins les éléments les plus marquants. « Ce sont des violences d’origine multifactorielle, précise le Dr Lise Meunier du Réseau Hépatite Saint-Pierre et coordinatrice du GT. Aux violences familiales s’ajoutent des violences conjugales, des violences dans la rue, mais aussi des violences institutionnelles. Au fond, il n’y a pas de réponse adaptée. Les violences institutionnelles sont probablement ce qui nous questionne le plus. Dans quelle mesure certaines de nos structures n’ayant pas intégré ces questions-là sont-elles source de violences institutionnelles ? Il y a là une dimension qui est insupportable pour les travailleurs et travailleuses sociaux puisque, a priori, nous n’avons pas envie nous-mêmes d’être source de violences institutionnelles. »
Dans quelle mesure certaines de nos structures n’ayant pas intégré ces questions de genre sont-elles sources de violences institutionnelles
Docteur Lise Meunier, Réseau Hépatite Saint-Pierre
La majorité des femmes de ce public ne sont pas en bonne santé. Beaucoup d’entre elles arrivent en effet tardivement dans les structures de soins, avec des problématiques plus lourdes. L’intrication des problèmes (consommation de produits, avec parfois travail du sexe, des problèmes sociaux, des problèmes avec la justice…) n’y est sans doute pas étrangère. Autre difficulté qui vient se greffer aux autres : la stigmatisation. Il faut plutôt parler de stigmatisations au pluriel, puisqu’il y a celle liée à l’usage de drogues, celle liée au genre. Et davantage encore, quand il y a une histoire de parentalité derrière : être mère et consommatrice n’est pas du tout bien vu socialement.