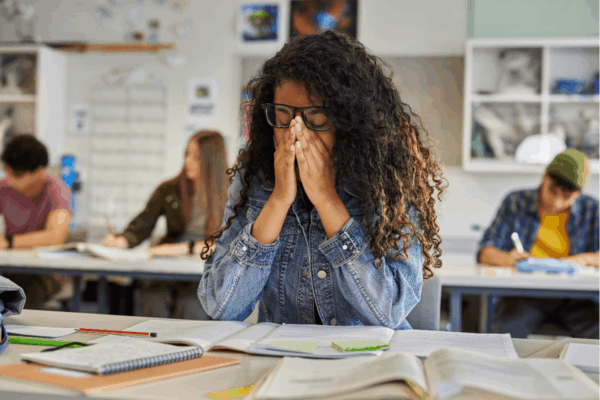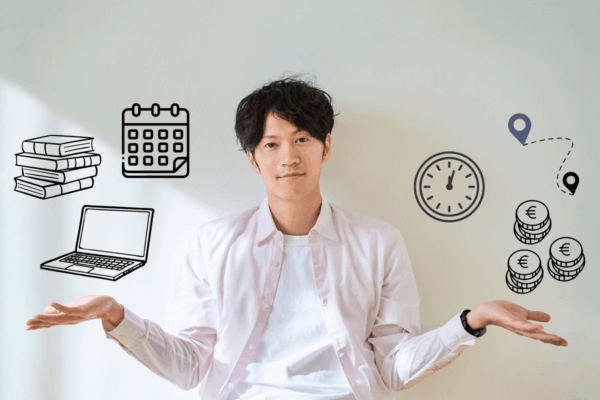Le stress et ses conséquences sur l’équilibre psychologique
Pour situer ces enjeux de santé mentale, il est utile de rappeler ce qu’est le stress, comment il fonctionne. Le stress est une réponse physiologique et psychologique de l’organisme face à une contrainte ou à une situation perçue comme dépassant ses capacités d’adaptation. Cette réaction est normale et même utile à court terme (stress aigu : ponctuel, lié à une situation immédiate, ex. un examen), mais elle devient problématique si elle persiste dans le temps ou devient excessive (stress chronique : prolongé, souvent lié à des problèmes persistants, ex. pression scolaire, soucis familiaux, etc.).
Le stress peut avoir des conséquences importantes sur la santé physique (système cardiovasculaire, immunitaire, digestif), mentale (anxiété, dépression, burnout) et sociale (absentéisme, baisse des résultats scolaires, isolement).
En somme, un peu de stress peut stimuler, trop de stress finit par bloquer.
Repérer les signes du stress chronique
Chez les enfants et les adolescents, le stress se manifeste de multiples façons :
- Physiques : maux de ventre, maux de tête, troubles du sommeil, fatigue, plaintes somatiques diverses.
- Émotionnelles : manque de confiance ou d’estime de soi, peur de l’échec, irritabilité, pleurs, découragement, déprime, anxiété.
- Comportementales : agitation, refus d’école, baisse de motivation, isolement, difficulté de positionnement dans l’environnement social, assuétudes, automutilations, agressivité.
- Cognitives : perte de concentration, trous de mémoire, baisse des résultats.
Ces manifestations varient selon l’âge, le contexte scolaire, le contexte familial et les appuis disponibles autour de l’élève.
En primaire, lors des apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, calcul) ou du CEB, le stress est souvent lié à la peur de décevoir les adultes. En secondaire, le stress augmente face aux examens, à la pression, à la charge de travail et aux changements sociaux et physiques de l’adolescence. En supérieur, les sources de stress peuvent être importantes également : la nouveauté, la charge de travail, les travaux de groupes, les blocus prolongés, les nouvelles exigences, les trajets, la charge horaire, la nécessité de jober pour certains, les craintes d’être non finançable, etc.
Des pics de stress peuvent être observés lors de périodes de transition : passage primaire-secondaire, choix d’orientation, examens certificatifs, passage en enseignement supérieur.
Mais au-delà de ces différences, le rôle du cadre – enseignants, parents, pairs – reste déterminant : la bienveillance, la pédagogie et le soutien social influencent fortement la capacité d’un jeune à faire face à la pression.
Encourager des comportements positifs
Pour prévenir un stress excessif, le SPSE UCLouvain insiste sur l’importance des gestes du quotidien :
- L’hygiène de vie : le sommeil, l’alimentation, la pratique sportive ou toute autre activité physique favorisant l’équilibre quotidien.
- Le bien-être personnel : la mise en place d’exercices de respiration, de cohérence cardiaque, de yoga, de relaxation, ou encore d’activités « exutoires » telles que l’expression orale ou écrite, le dessin, les sorties nature ou le sport.
- Le cadre de travail : l’importance d’un environnement propice aux apprentissages, des conseils d’organisation et de planification, ainsi que des techniques de mémorisation et de restitution adaptées.
- Le recours à l’aide et aux ressources disponibles : encourager la parole, l’expression des émotions et la recherche de personnes ressources — qu’elles soient issues de l’entourage familial, amical, scolaire ou du réseau professionnel.
Quand le stress devient trop lourd
Lorsque les signes s’intensifient, le SPSE joue un rôle d’aiguillage vers les ressources adaptées : parents, professionnels de santé, PMS, équipe éducative, services sociaux ou psychologiques. « Pouvoir orienter le jeune de la manière la plus adaptée et la plus efficace possible constitue un enjeu central pour des services comme les nôtres », souligne la docteure Séré, responsable du SPSE. L’orientation et la collaboration représentent les piliers essentiels au fonctionnement du SPSE : repérer, accompagner, orienter.
Selon la situation, cette orientation peut concerner les parents, les professionnels de la santé, les services PMS, l’équipe éducative, les organismes de soutien, les plannings familiaux, ou encore les points-santé et services sociaux présents dans les hautes écoles, etc.
À noter que le regard du SPSE se distingue de celui du PMS. Là où le PMS accompagne l’élève individuellement sur le plan psychologique et pédagogique, le PSE tente de gérer le stress avant qu’il ne devienne excessif, en favorisant un équilibre global.