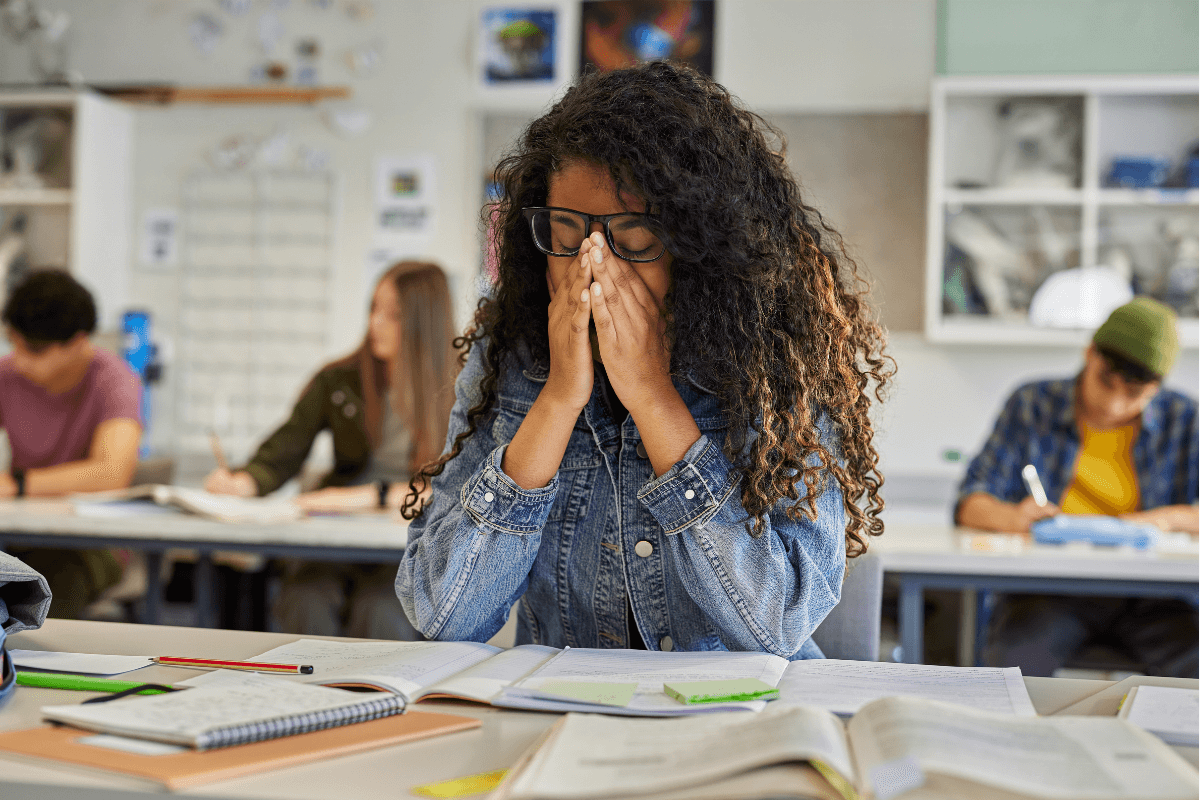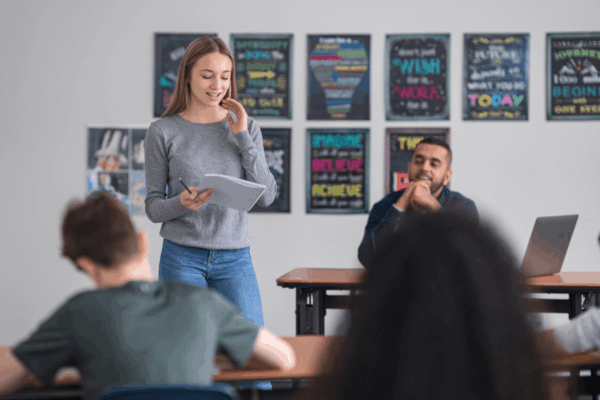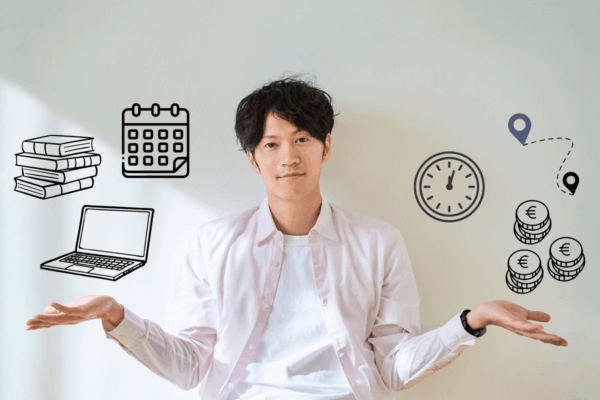Quand le stress devient symptôme
La pédopsychiatre Sophie Maes, médecin de référence chez Bru-Stars, le Réseau Bruxellois en Santé Mentale pour les Enfants et Adolescents, et interrogée en 2024 par le magazine Éduquer, observe cette évolution depuis des années. Selon elle, la crise du COVID-19 a agi comme un révélateur. En privant les jeunes de liens sociaux, elle a mis en lumière les fragilités d’un système scolaire déjà très exigeant.
« Les adolescents ont perdu leur appareil à penser collectif », explique-t-elle, évoquant le rôle crucial du groupe d’amis dans la construction de soi. Sans ce soutien, l’école peut devenir solitude — voire angoisse.
Aujourd’hui, le stress scolaire ne se limite plus aux périodes d’examens. Il s’installe au quotidien, nourri par la peur de l’échec, le regard des autres, ou les difficultés relationnelles. Certains jeunes vivent l’école comme un espace de mise à l’épreuve permanente, où il faut sans cesse prouver sa valeur. Les élèves présentant des troubles d’apprentissage ou manquant de repères familiaux y sont d’autant plus vulnérables.
L’adolescence, avec ses bouleversements identitaires et corporels, amplifie encore cette fragilité. Les comparaisons se multiplient, le jugement des pairs devient omniprésent. C’est souvent à ce moment-là que surgissent des formes plus sévères d’anxiété : crises de panique, refus scolaire, voire phobie scolaire. Pour Sophie Maes, ce n’est pas une « maladie », mais une réaction compréhensible à un environnement ressenti comme menaçant.
« L’enseignement actuel, centré sur la performance et peu attentif aux émotions, contribue à dégrader la santé mentale des jeunes », souligne-t-elle.
Elle plaide pour une école qui ne soit pas seulement un lieu de transmission, mais aussi un espace de régulation émotionnelle, où l’on apprend à coopérer, à nommer ce que l’on ressent et à faire preuve d’empathie.
Repérer le stress, l’écouter et l’accompagner devient alors une véritable prévention. Un élève qui s’isole, qui s’énerve facilement ou dont les résultats chutent envoie souvent un signal d’alarme. En parler avec les élèves et les parents, renvoyer vers le Centre PMS, voire impliquer les enseignants, solliciter un médecin ou un service spécialisé… Ouvrir le dialogue est un premier pas pour éviter que le stress, d’abord adaptatif, ne vire à la souffrance durable.