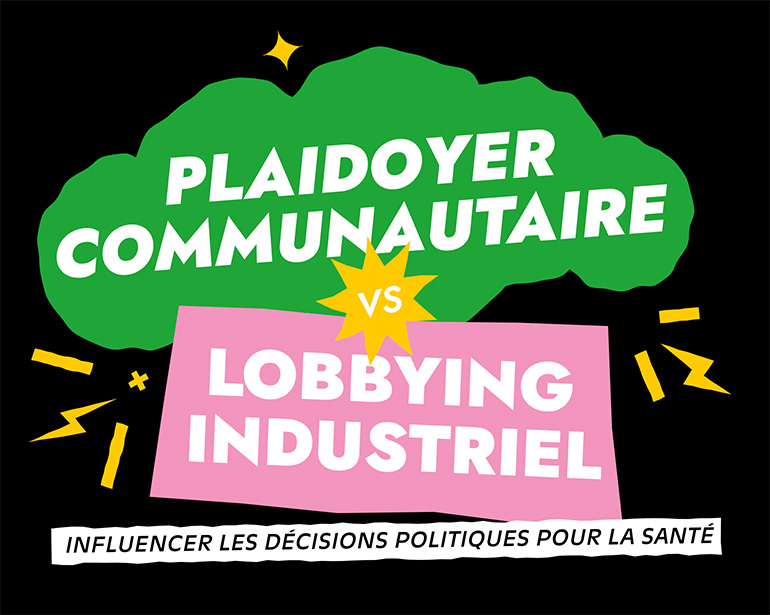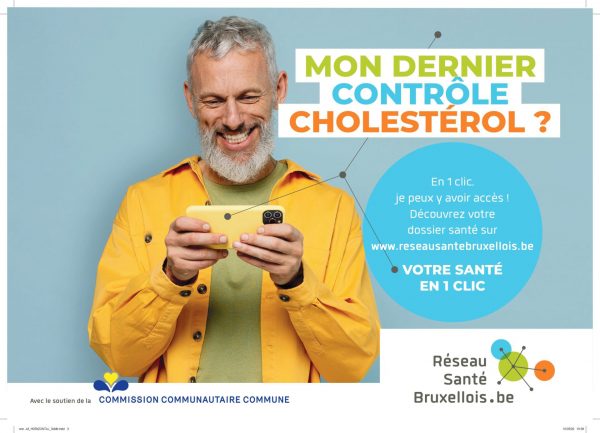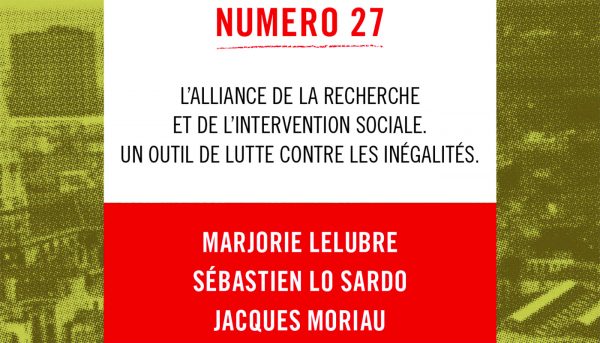La fabrique du doute
L’intervention de Stéphane Horel, journaliste au Monde spécialiste de la question des lobbys industriels, notamment dans le domaine de la chimie, et auteure du livre « Lobbytomie »[2], a certainement renforcé le sentiment d’une nécessité de contre-pouvoirs face aux lobbys industriels.

C’est en expliquant les mécanismes utilisés par ces derniers que la journaliste a mis en exergue la force de frappe et les procédés d’intervention de ces acteur·trice·s sur le processus législatif « en supprimant, édulcorant, retardant l’action politique ou en la détournant pour ses propres fins, en répétant « le bon message à la bonne personne au bon moment ». Leur stratégie : participer à la rédaction de la loi en y injectant leurs propres considérations. On parle dès lors de capture du régulateur. »
La journaliste a décrit les lobbys, « non pas comme de petits êtres fantastiques », mais comme des structures extrêmement organisées et dotées de moyens financiers considérables, allant des fédérations de secteurs aux firmes lobbyistes et aux cabinets de lobbying et de relations publiques, en passant par les associations sectorielles, les cabinets d’avocats ou encore les think tanks. Les cibles : la Commission européenne, les agences, les représentations politiques, les États membres, mais aussi le Parlement européen, les députés, les partis, avec la hiérarchie propre à chacun de ces lieux de pouvoir. Elle a insisté sur la capacité et les moyens de ces lobbys (avec moultes exemples comme celui, le plus connu, de l’industrie du tabac) « à bidouiller la science en sponsorisant des articles scientifiques orientés, en créant la controverse, la confusion, en jouant sur les concepts de preuve et de multicausalité afin de créer le doute. »
Face à cela, Stéphane Horel a salué le travail des ONG et l’intérêt des projets communautaires, malgré l’efficacité redoutable et la force de frappe des grosses entreprises et des secteurs industriels.
La stratégie des lobbys industriels : participer à la rédaction de la loi en y injectant leurs propres considérations. On parle dès lors de capture du régulateur
Stéphane Horel