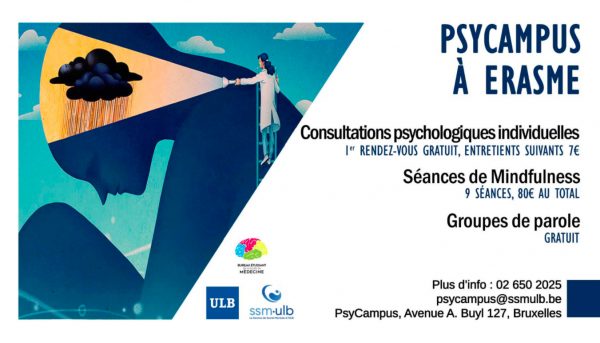Comment augmenter leur résilience ?
B.S. : Il faudrait certainement davantage de moyens, de ressources pour les soigner. Cependant, dans une allocution faite devant le Parlement francophone bruxellois en début d’année, la pédopsychiatre Sophie Maes soulignait que le problème n’était pas tant les moyens, mais plutôt un environnement qui rendait les jeunes malades. Leur donner un contexte éducatif de qualité, bienveillant et à leur écoute les aiderait davantage.
C.W. : Elle a raison, bien que des ressources soient également nécessaires pour créer des espaces où ils peuvent parler. Mais pour parler, il faut qu’ils aient confiance. Et prendre la parole, cela s’apprend. Ce n’est pas du jour au lendemain qu’on arrive à exprimer ses besoins, ses ressentis. Il faut des lieux sécurisants. Leur donner une vraie place et les écouter seraient déjà un bon début. À Bruxelles, il existe quelques projets qui le font. On ne peut qu’espérer que ceux-ci leur permettront d’être résilients.
Il faut des tuteurs, parce que les jeunes ne vont pas rebondir seuls, il leur faut des appuis
Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre et psychanalyste français qui a popularisé le concept de la « résilience », parle de « tuteurs de résilience ». Il faut des tuteurs, parce que les jeunes ne vont pas rebondir seuls, il leur faut des appuis. Cela peut être un·e enseignant·e, un·e « psy », un·e professeur·e de sport, etc. Et si cela est possible, il en faut plusieurs. Toute personne peut être tuteur, mais il faut quand même que le jeune y ait accès.
L’accès à la parole est aussi un tuteur. Être acteur·trice de changement est également une autre manière de venir faire résilience. En étant des acteurs de changement, les jeunes font alors quelque chose des difficultés qu’ils repèrent. Comme dans le projet « Jeunes et santé mentale » mené à la Ligue bruxelloise pour la santé mentale (voir second article du dossier) et qui fait participer des jeunes. Chass’Info et Bru-Stars, le réseau bruxellois en santé mentale pour enfants et adolescents, mènent aussi des projets participatifs avec des jeunes.
Comme référente psychologue au projet mené à la Ligue, il faut souligner que les jeunes, qui venaient de tous les milieux confondus, ont été très impliqués, avec un grand respect entre eux. Leur implication a été remarquable et c’est peut-être là où réside l’espoir : quand nous leur ouvrons des portes, créons des espaces de rencontre, ils y vont. Ils investissent ces lieux. Peut-être faudrait-il miser là-dessus. Et si nous arrivons à articuler tous les niveaux de pouvoir, sans exclure les jeunes de la chaîne des décisions, alors les choses recirculeront et cela leur redonnera une place dans la société. Et une place dans la société est quand même un facteur de résilience.