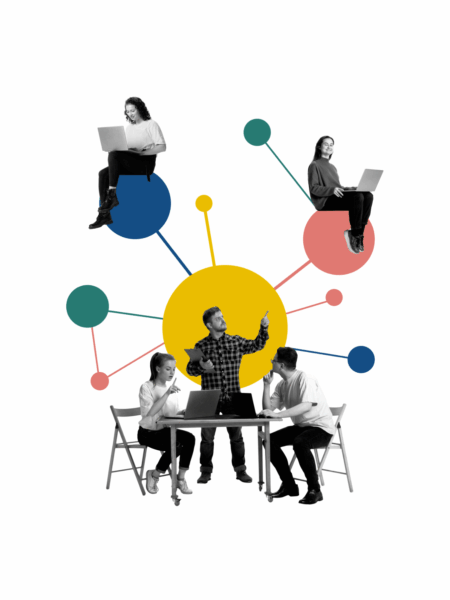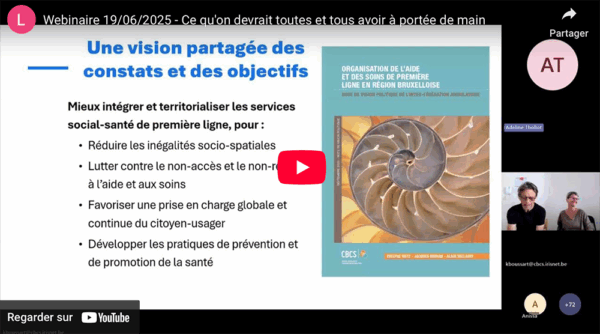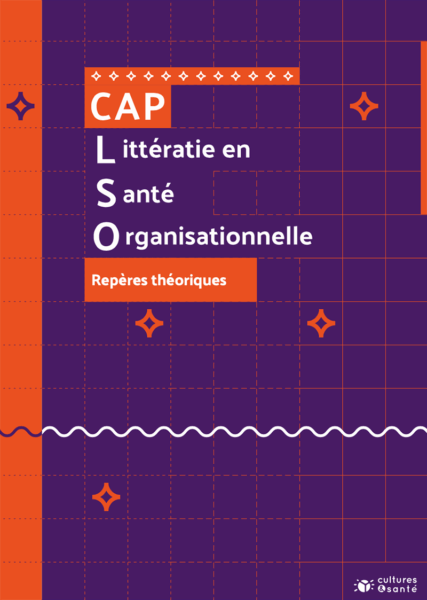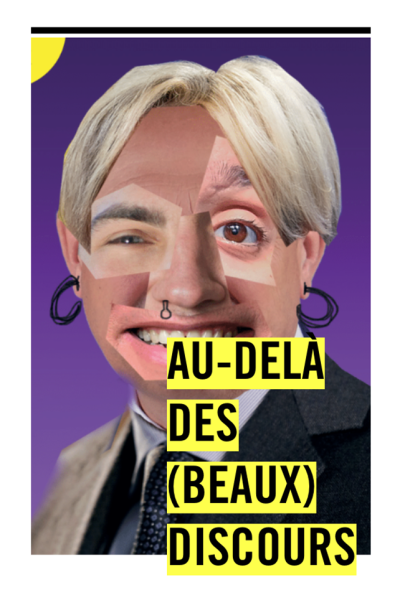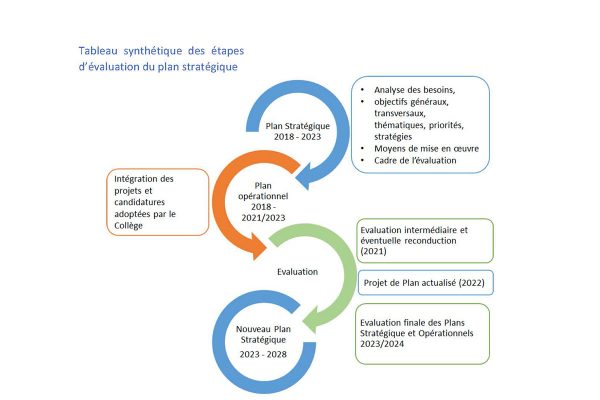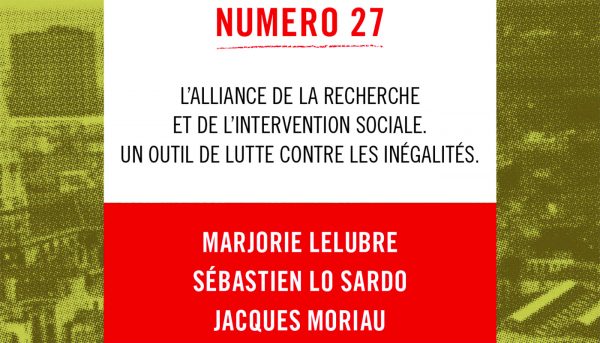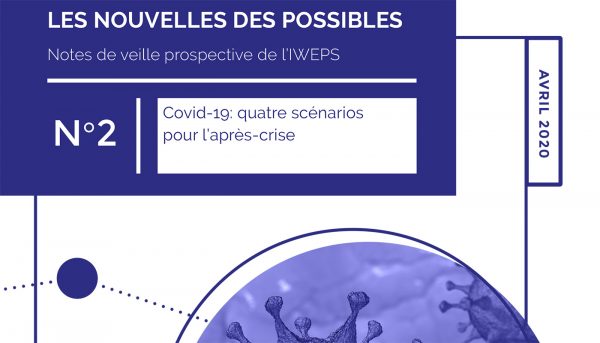L’idée de l’universalisme proportionné naît lui-même d’un constat : « Si la santé s’est globalement améliorée à l’échelle de la population, cette évolution s’est paradoxalement accompagnée d’un accroissement des inégalités sociales de santé. Dans ce contexte, le cadre d’intervention défini par la promotion de la santé engage tant les acteurs de terrain que les responsables politiques à agir en faveur de la réduction des inégalités sociales de santé. Pour lutter contre les inégalités, ce cadre repose sur des stratégies d’action ciblant l’ensemble des déterminants de la santé et prenant en compte les situations de vulnérabilités susceptibles d’affecter tout groupe social[1] ». Le concept est évoqué pour la première fois par un groupe de chercheurs britanniques, dont Michael Marmot spécialiste en épidémiologie et en santé publique, dans le rapport Fair Society Lives (2010) où ils cherchent « à offrir une alternative à la tendance des politiques de santé consistant à cibler les zones géographiques et les populations présentant le plus de vulnérabilités, au détriment de politiques universelles. Or les approches ciblées ont montré avoir peu d’effet sur la réduction des inégalités de santé[2] ».
L’universalisme proportionné est défini comme étant une approche consistant en « des actions qui devraient être universelles, mais avec une intensité et une ampleur qui sont proportionnelles au niveau du désavantage[3] ». Elle consiste à assurer l’existence d’une offre de services et d’interventions accessibles à l’ensemble de la population (universalisme) et ajustables en fonction des besoins de santé spécifiques (proportionné). L’objectif est de dépasser les limites des approches consistant à développer, soit des mesures universelles sans lever les barrières d’accès aux groupes de personnes en situation de vulnérabilité, soit des mesures ciblées qui peuvent induire une stigmatisation des bénéficiaires et exclure injustement certains publics. L’universalisme proportionné invite à intégrer ces deux approches de manière cohérente[4].
Quand des acteurs se saisissent de l’approche
Si des interrogations sur la mise en place demeurent, il n’empêche que le concept séduit de plus en plus des professionnels du socio-sanitaire. A l’instar de Médecins du Monde France (MDM) qui intervient auprès des personnes en situation de grande précarité, dans le but de promouvoir ou faciliter leur accès aux droits et aux soins. Les femmes qui sont accueillies dans ses programmes cumulent par exemple de nombreux facteurs de risque de développer des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus et sont également particulièrement éloignées des dispositifs de soins et de prévention. En réponse à ces constats, les équipes de MDM ont développé une stratégie d’universalisme proportionné pour améliorer l’accès à la prévention pour les publics très précarisés, en allant au-devant des populations et en proposant des consultations spécifiques de prévention[5].
Pour réduire les inégalités de santé, MDM développe différentes stratégies et ceci passe par une combinaison de plusieurs méthodes, parmi lesquelles la médiation en santé et l’accès à une information claire et adaptée via l’interprétariat professionnel et à des consultations réalisées par des équipes sensibilisées au counselling[6]. Le but de ces actions ? Favoriser les approches multisectorielles, avec des interventions multiniveaux, tout en créant les conditions de la participation des publics et en favorisant l’empowerment à travers le développement et la diffusion d’outils spécifiques[7].
Des questions subsistent
Un autre exemple de l’approche de l’universalisme proportionné est son utilisation pour améliorer la santé des minorités « LGBTI+ »[8]. Pour rejoindre cet objectif, il faut s’assurer que les politiques de santé élaborées obéissent à un impératif d’inclusivité en matière de sexe et de genre pour améliorer la santé de tous. Une belle illustration en est donnée avec une des mesures prises pour protéger les femmes – et leurs enfants – victimes de violences intrafamiliales[9]. Parce que les filles et les jeunes LGBTI sont les populations les plus touchées par ces dernières[10], un financement et des dispositifs d’aide ont été mis en place pour les protéger. Si ces dispositifs sont utiles, « on peut néanmoins s’interroger sur le choix d’y faire entrer les personnes en fonction de leur genre, de leur sexe, ou de leurs préférences sexuelles, plutôt qu’en fonction des violences qu’elles subissent. Car ce faisant, les personnes – certes minoritaires – n’entrant pas dans les catégories ciblées ne disposent d’aucun dispositif auquel recourir[11] ». Ainsi qu’en est-il par exemple des hommes victimes des violences de leur conjoint ou conjointe ou des personnes LGBTI (plus) âgées ?
Actuellement, l’approche de l’universalisme proportionné semble faire consensus : comment ne pas favoriser davantage l’accès aux droits et améliorer l’accès aux soins de santé pour tous, notamment ceux des populations les plus précarisées ? Ici et là, des mesures sont prises dans ce sens. Cependant, comme le souligne le RESO, cette approche n’est pas encore suffisamment étayée car des questions et des difficultés quant à leur mise en place demeurent. Si les pouvoirs publics voient bien l’utilité du concept et la finalité qui est de réduire les inégalités sociales de santé, il est nécessaire d’accorder plus de moyens pour la recherche, les projets de mise en pratique, la formation/l’information et l’évaluation. C’est pourquoi la mise en place du Plan Social-Santé Intégré (PSSI) mérite l’attention de tous les acteurs car il fait quelque part office d’un test grandeur nature (Voir l’article Une étape supplémentaire dans la mise en place du PSSI, également publié dans cet e-Mag Bxl santé).
Anoutcha Lualaba Lekede
[1] Guiheneuf C., Malengreaux S., Aujoulat I., Ferron C., Doumont D., Inscrire les actions dans une approche d’universalisme proportionné. Bruxelles : UCLouvain/IRSS-RESO, mai 2025, p. 1.
[2] Idem, p. 2.
[3] Ibidem, p. 2.
[4] Ibidem, p. 2.
[5] Laurence S., Lallemand A., Chappuis M., Rochefort J., « Médecins du monde et le principe d’universalisme proportionné appliqué à la prévention du cancer du col de l’utérus », dans Dépistage des cancers 2019/HS2, p. 53.
[6] Le counselling est une forme d’intervention brève, de nature thérapeutique et/ou éducative, qui a pour objectif d’aider une personne à mobiliser ses propres ressources afin de faire face à une situation et faciliter un changement de comportement.
[7] Laurence S., Lallemand A., Chappuis M., Rochefort J., idem, p. 57.
[8] Selon l’acronyme utilisé dans la littérature française.
[9] Grenouilleau-Albertini A.-S., Suarez T., Saoul C., « L’universalisme proportionné, un outil pour améliorer la santé des minorités LGBTI », dans Santé des minorités sexuelles, sexuées et de genre 2022/HS2, p. 33.
[10] Pendant les périodes de confinement lié au Covid-19, les violences intrafamiliales ont fortement augmenté. C’est à la suite de ce constat que des mesures ont été prises et certains dispositifs mis en place.
[11] Grenouilleau-Albertini A.-S., Suarez T., Saoul C., idem.